L’autopsie non sentimentale de l’Inde des années 70, l’une des décennies les plus turbulentes du pays, réalisée par Raghavan, est une étude opportune de la manière dont le pouvoir politique peut être utilisé pour faire plier l’échafaudage de la démocratie. Il se propose d’offrir « un antidote à l’illusion de chaque génération que ses propres problèmes sont uniquement oppressifs », mais les thèmes du livre résonnent d’une manière que même l’auteur n’a peut-être pas entièrement anticipée. Gandhi, la fille du premier Premier ministre indien, Jawaharlal Nehru, est souvent dépeinte comme une stratège cynique et omnisciente ou comme une dynaste infortunée. Mais Raghavan démonte astucieusement ces deux caricatures.
Son Gandhi est un improvisateur consommé, opérant dans les « limites » fixées par l’inertie bureaucratique, les chocs économiques, l’effritement du parti du Congrès et l’incertitude géopolitique de la guerre froide. Ce monde n’était pas tout à fait différent de celui dans lequel le Sud se trouve apparemment enfermé aujourd’hui.
Gandhi a répondu à ces pressions avec audace – parfois avec brio, parfois avec témérité, mais toujours avec un instinct infaillible pour consolider son pouvoir personnel. Ce cadrage est important. Raghavan rejette le déterminisme paresseux qui suggère que les dirigeants n’ont « pas le choix ». Au contraire, il met en évidence l’action politique – et la responsabilité morale – qui détermine toujours l’héritage politique.
C’est une leçon que les dirigeants d’aujourd’hui feraient bien de prendre en compte. Elle met également en place la tension centrale du livre : la transformation au détriment des garde-fous démocratiques. Aucun épisode n’illustre mieux ce compromis que la fameuse urgence de 1975-1977. Après qu’un tribunal a invalidé son élection au Parlement indien, Gandhi a déclaré l’état d’urgence, suspendu les libertés civiles, censuré la presse et sanctionné des détentions massives.
Raghavan traite cet épisode sous l’angle de la médecine légale plutôt que sous celui de la prédication. Mais les faits parlent d’eux-mêmes. Il s’agit de la première grande rupture démocratique de l’Inde, une leçon de choses sur la façon dont les outils d’une Constitution peuvent être retournés contre son esprit. L’état d’urgence sert aussi, étrangement, de miroir aux « hommes forts » d’aujourd’hui, qui s’appuient sur les mêmes types de justifications juridiques, de rhétorique de sécurité nationale et de dénigrement des opposants. Raghavan n’est pas un propagandiste pour un parti en particulier, mais l’accueil réservé à son livre montre que même les études les plus méticuleuses n’existent pas dans le vide. Il est devenu un autre élément de la guerre culturelle indienne, qui est désormais un phénomène familier dans les démocraties du monde entier.
Depuis l’arrivée au pouvoir du Premier ministre indien Narendra Modi en 2014, le parti au pouvoir, le Bharatiya Janata Party, n’a cessé de chercher à discréditer le parti du Congrès (qui a gouverné l’Inde pendant 54 ans) et la dynastie Nehru-Gandhi. Dans ce contexte, un récit richement détaillé du tournant autoritaire de Gandhi, aussi équilibré soit-il, peut devenir un cadeau pour le pouvoir en place.
Il ne s’agit pas de blâmer Raghavan, mais plutôt de reconnaître une vérité qui est trop souvent éludée dans les cercles polis : une fois que l’histoire quitte les archives, elle devient une matière première pour le présent. La citation sélective, dépouillée de toute nuance, est un sport bipartisan, et l’urgence peut être déployée pour marquer des points politiques aussi facilement qu’elle peut être étudiée pour comprendre la fragilité de la démocratie.
Pourtant, la « dame de fer » de l’Inde est un personnage fascinant et durable. De sa naissance en tant que fille adorée d’un père célèbre (et mère d’un futur premier ministre, Rajiv Gandhi) à ses 15 années de pouvoir, en passant par son sens du style et son assassinat (par ses gardes du corps sikhs en 1984), tout est matière à une biographie passionnante. Raghavan a le mérite de résister à la tentation de présenter son sujet comme une simple mise en garde.
Ainsi, il reconnaît comme il se doit ce que Gandhi appellerait ses grandes réalisations, de la victoire rapide dans la guerre de 1971 avec le Pakistan, qui a donné naissance au Bangladesh, à l’essai nucléaire de 1974, qui a établi l’indépendance stratégique de l’Inde, en passant par la nationalisation des industries bancaires et pétrolières indiennes. Il ne s’agissait pas de gestes symboliques. Ils ont modifié la réalité économique et géopolitique de l’Inde. Raghavan démontre qu’ils étaient inséparables de la centralisation de l’autorité de Gandhi à New Delhi et au bureau du Premier ministre.
Mais l’esprit de décision qui a permis des changements rapides a également réduit la capacité du Congrès à débattre en interne. Il en est résulté une organisation plus rationalisée à court terme, mais plus fragile à long terme. En reconstituant les années 70, Raghavan nous offre une étude de cas sur le dilemme universel des dirigeants politiques soumis à un stress systémique. Lorsque la légitimité s’effrite et que les institutions vacillent, même les dirigeants démocratiques sont tentés par des raccourcis autoritaires.
Faire ce qui est le plus opportun est plus susceptible de produire des résultats visibles, du moins dans un premier temps. Mais violer les normes et saper les institutions, c’est nourrir une culture politique qui ne demande qu’à se perpétuer.
De l’Amérique latine à l’Europe de l’Est et au-delà, les règles du jeu sont bien connues : construire la légitimité par la gestion de crise, présenter la dissidence comme du sabotage (ou de la « trahison ») et centraliser la prise de décision pour « faire avancer les choses ». L’état d’exception qui commence en réponse à une « urgence » devient trop souvent la nouvelle normalité.
La méthodologie de Raghavan est elle-même une provocation implicite. Il écrit à la fois avec une rigueur archivistique et une culture politique, montrant comment les contraintes structurelles et les choix personnels se heurtent en temps réel. Mais c’est ce double regard qui rend le livre dangereux.
En révélant les rouages du pouvoir, il constitue à la fois un avertissement et un manuel d’instruction. Indira Gandhi et les années qui ont transformé l’Inde est plus qu’une biographie politique. C’est une étude des mécanismes du pouvoir, de la fragilité des institutions et de l’inconfortable réalité selon laquelle la transformation et l’érosion démocratiques sont susceptibles de partager la même route.
L’histoire de Gandhi, racontée en 2025 (et rafraîchie par l’absence de tout romantisme « woke » d’une formidable dirigeante), est un rappel poignant de la nature ténue de la démocratie. En cette période de montée du politiquement incorrect, il est perversement ironique que le premier homme fort de l’après-guerre ait été une femme.
Par Antara Haldar
Professeur associé d’études juridiques empiriques à l’Université de Cambridge et membre du corps professoral invité à l’Université de Harvard.

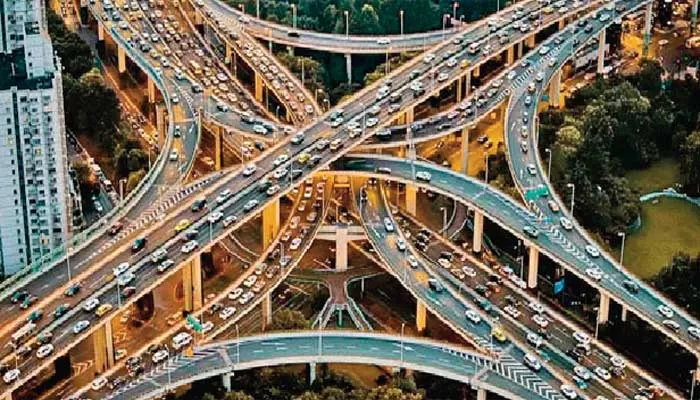


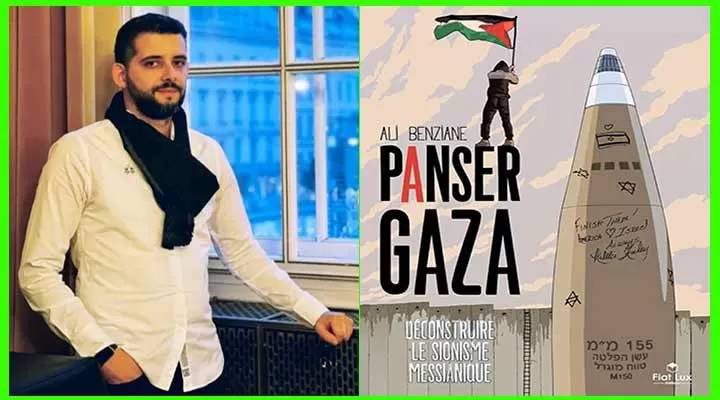






Commentaires
0