La question s’impose aujourd’hui avec une brutalité inhabituelle : le Maroc souffre-t-il parce que les temps sont durs ou parce que la politique a disparu du champ de décision ?
La loi de Finances 2026 ne répond pas à cette question : elle la confirme. Loin d’être un document comptable, elle consacre la fin d’un cycle politique, révèle une économie épuisée, une société fracturée, un territoire déséquilibré et un exécutif sans boussole. Comment un pays peut-il progresser lorsque ses choix stratégiques s’affranchissent de l’esprit constitutionnel, négligent les besoins de la population et affaiblissent son avenir commun ?
1. Un pays sous pression : l’explosion des indicateurs sociaux révèle l’effacement politique
Les indicateurs sociaux dessinent un pays placé sous tension permanente. Avec plus de 37 millions d’habitants dont plus d’un tiers de jeunes, le Maroc dispose d’un potentiel démographique considérable qui devrait être un levier de transformation. Il est devenu au contraire une source d’inquiétude collective. Le chômage des jeunes dépasse les 38%, l’inactivité générale s’installe durablement, et une majorité de jeunes exprime ouvertement le désir de quitter le pays, révélant un décrochage entre la société et son horizon économique.
Le pouvoir d’achat continue de s’effriter sous le poids d’une inflation alimentaire qui dépasse les 11%, tandis que les dépenses essentielles absorbent une part disproportionnée des revenus des ménages. Le recours massif au crédit, qui dépasse aujourd’hui les 430 milliards de dirhams, traduit moins une dynamique de consommation qu’une stratégie de survie, d’autant que les impayés atteignent des niveaux alarmants.
Dans le monde rural, la pauvreté multidimensionnelle persiste au-delà de 17%, et près de six millions de Marocains vivent dans une vulnérabilité structurelle. Ces chiffres, pris globalement, ne traduisent pas une simple conjoncture difficile : ils révèlent les effets directs d’un effacement politique qui laisse les politiques publiques évoluer sans cohérence, sans priorités, sans vision nationale. Lorsque la politique s’éclipse, le social se dégrade, et c’est l’ensemble du contrat national qui se fissure.
2. Une économie sans moteur : croissance faible, emploi dégradé et finances publiques sous tension
L’économie marocaine avance sans direction claire et sans moteur solide. La croissance peine à dépasser les 2,7%, alors que le pays a besoin d’un rythme bien supérieur pour absorber les effets de sa démographie et soutenir l’emploi. Le marché du travail s’enlise : les créations d’emplois sont dérisoires, les pertes dans le secteur agricole atteignent des niveaux massifs, et la transition vers des emplois industriels stables demeure quasi inexistante.
Le pays reste dépendant des importations pour son énergie, ses besoins céréaliers et une large partie de ses intrants industriels, ce qui expose l’économie aux fluctuations internationales et réduit les marges souveraines de décision. Le déficit commercial dépasse 290 milliards de dirhams, l’épargne nationale reste faible, l’investissement privé stagne autour de 28%, et la dette publique atteint un niveau jamais atteint depuis les années 80, flirtant dangereusement avec la barre des 95% du PIB.
Cette vulnérabilité structurelle ne tient pas seulement à la conjoncture mondiale : elle résulte d’un abandon progressif de la planification publique, d’une incapacité à construire des chaînes de valeur nationales solides, et d’un pilotage économique qui s’apparente davantage à une logique de gestion du quotidien qu’à une stratégie de développement. Une économie sans vision finit toujours par devenir une économie sous perfusion.
3. L’impasse néolibérale : quand l’idéologie remplace l’Etat et entraîne l’échec des politiques publiques
L’une des causes majeures de la crise actuelle réside dans l’adoption d’un modèle néolibéral appliqué mécaniquement, sans adaptation, sans discernement et sans évaluation. Depuis quatre ans, la majorité gouvernementale a réduit la présence de l’Etat dans des secteurs où il est pourtant indispensable, affaibli les instruments de régulation, renoncé à la planification territoriale et confié la dynamique économique au marché, comme si celui-ci pouvait spontanément produire de l’équité, de l’emploi et de la cohésion sociale.
Cette vision a fragilisé les services publics. Dans la santé, le pays ne compte que sept médecins pour dix mille habitants, et souffre d’une pénurie majeure de personnel infirmier et d’infrastructures dont plus de la moitié date d’une époque lointaine. Dans l’éducation, des centaines de milliers d’élèves quittent chaque année l’école, les classes sont surpeuplées, les retards d’apprentissage s’accumulent, et les enseignants manquent par milliers. Dans la protection sociale, les mécanismes sont mis en œuvre sans financement durable, sans évaluation continue et sans architecture claire, transformant un chantier historique en une succession de dispositifs incomplets.
Le marché n’a pas corrigé ces failles ; il les a aggravées. Le chômage des jeunes demeure massif, l’investissement privé ne prend pas le relais de l’investissement public, et le tissu productif se concentre dans quelques zones, accentuant les fractures territoriales. L’idéologie a pris le pas sur l’Etat, et le résultat est sans appel : un modèle qui ne construit plus, qui ne protège plus, et qui ne produit ni justice ni efficacité.
4. Une loi de Finances qui officialise la faillite de la majorité
La loi de Finances 2026 révèle l’ampleur de l’impasse. Ce budget ne marque aucune rupture stratégique, ne corrige aucun déséquilibre, n’ouvre aucune perspective nationale. Il se contente de confirmer les mêmes choix qui ont déjà montré leurs limites : un financement insuffisant des secteurs sociaux, une architecture fiscale qui évite toujours la véritable progressivité, une programmation territoriale fragmentée, un recours massif à la dette au détriment d’une stratégie de souveraineté productive, et une absence totale de vision pour 2030 et au-delà. Loin de préparer l’avenir, cette loi entérine l’échec d’un modèle qui a renoncé à gouverner. Elle confirme qu’un exécutif sans vision ne peut produire qu’un budget sans ambition, un pays sans cohérence et une société sans horizon.
Conclusion – Sortir de l’impasse : réarmer l’Etat, réhabiliter la politique et choisir une alternative sociale-démocrate
La crise que traverse le Maroc n’est ni accidentelle ni temporaire. Elle est le résultat direct d’un choix idéologique qui a affaibli l’Etat, fragmenté le territoire, aggravé les inégalités et miné la confiance citoyenne. Le pays ne manque pas de ressources : il manque de cap, de vision et de courage politique.
Sortir de l’impasse exige de réhabiliter le rôle de l’État, de replacer la politique au cœur de la décision publique, de reconstruire un Etat social solide, de planifier le développement économique sur le long terme et de rétablir la confiance entre les institutions et les citoyens.

En 2026, les citoyens ne choisiront pas seulement un programme gouvernemental : ils choisiront un modèle de société. Ils auront le pouvoir de sanctionner l’échec néolibéral ou d’ouvrir la voie d’une nouvelle espérance nationale, fondée sur la justice sociale, la responsabilité politique et l’Etat social.
Mohamed Assouali
Secrétaire provincial de l’USFP à Tétouan

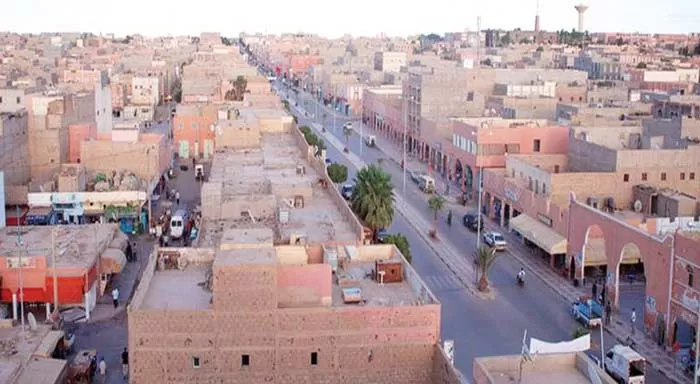

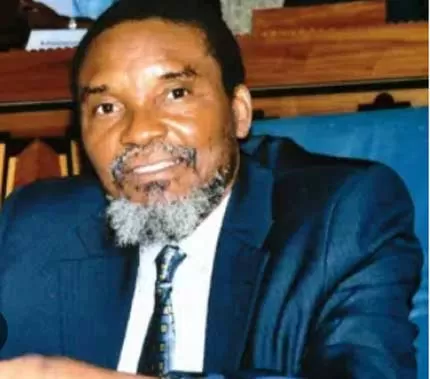







Commentaires
0